Contre la littérature du nombril
- Isabelle Alexandrine Bourgeois

- 3 nov. 2025
- 3 min de lecture
Chronique d’Élodie Perrelet, créatrice du blog littéraire La Vie Ardente
Il y a des pays qui se ferment, des langues qui se replient, et des littératures qui se regardent écrire comme Narcisse son reflet. L’époque veut qu’on s’écoute beaucoup, qu’on s’écrive soi-même avec application, qu’on confonde l’introspection avec la claustration. Pourtant, la littérature — la vraie, celle qui respire, celle qui dérange — commence toujours ailleurs. Elle naît quand on franchit une frontière.
Lire, c’est traverser. Traverser une langue, une culture, un fleuve, parfois un soi-même trop étroit. Lire, c’est faire un pas de côté — ou plutôt, un pas dehors. Le roman n’a jamais été une chambre close : c’est un port, une douane, un passage clandestin.
Prenons Miguel Bonnefoy. Franco-vénézuélien, fils d’un diplomate chilien et d’une mère vénézuélienne, il écrit en français — mais son français sent la mangrove, la canne à sucre et la nostalgie des exils. Dans Héritage, il fait courir sa saga familiale des vignes du Jura jusqu’aux Andes, et prouve qu’on peut écrire dans la langue de Molière tout en parlant le vent des tropiques. Il ne francise pas le monde : il tropicalise le français.
Mohamed Mbougar Sarr, lui, vient du Sénégal. Il écrit lui aussi en français — et c’est peut-être là sa première insoumission. La plus secrète mémoire des hommes interroge ce que c’est qu’écrire depuis la marge : être lu, traduit, réduit, catalogué. Chez lui, la frontière n’est pas géographique : elle est symbolique. Il refuse le regard exotique, il refuse le regard paternaliste. Il rend au français sa capacité d’accueil — pas celle d’assimiler, mais celle d’écouter.

Et puis, tout récemment, le Nobel 2025 : László Krasznahorkai, Hongrois mélancolique dont les phrases s’étirent comme des processions de saints ivres dans un monde en ruine. En le lisant, on comprend que la littérature de l’Est a ce pouvoir d’inquiéter nos certitudes de l’Ouest : c’est une prose d’après la fin du monde, mais qui continue d’espérer.
Trois écrivains, trois frontières franchies, trois façons de rappeler qu’une langue n’est pas un drapeau.
Or nous, lecteurs francophones, avons parfois ce travers national : croire que l’universel s’écrit en français ; que tout ce qui ne passe pas par Paris, ou Genève, ou Bruxelles, est une curiosité provinciale. C’est faux, et c’est triste. La littérature n’est pas un pays à défendre, c’est un territoire à explorer.
On s’émerveille d’un paysage, d’une coutume, d’un accent, mais on hésite à s’émerveiller d’une syntaxe étrangère. On se gave de séries coréennes et de sushis au saumon, mais dès qu’un roman sort du cadre hexagonal, on demande : « C’est traduit ? » — comme si la traduction était un visa de séjour temporaire.
Franchir les frontières, c’est plus qu’un geste de curiosité : c’est un acte de santé mentale. C’est refuser la claustrophobie littéraire. C’est reconnaître qu’une langue vit d’être traversée par d’autres. Que le français, s’il veut rester grand, doit cesser d’avoir peur de se perdre.
Car ce n’est qu’en se frottant à d’autres musiques qu’il retrouvera son timbre. Qu’en lisant un poète de Dakar, un romancier de Caracas ou un visionnaire de Budapest, il se découvrira à nouveau capable de surprise.
Miguel Bonnefoy, Mbougar Sarr, Krasznahorkai : trois manières de rappeler que la littérature n’a pas de passeport, seulement des lecteurs assez téméraires pour passer la douane.
Alors, pour une fois, laissons tomber les récits qui tournent en rond sur le carrelage du moi. Prenons le risque du dehors. Laissons l’air des autres souffler dans nos phrases.
Franchir les frontières, c’est peut-être la seule manière qu’il nous reste d’habiter le monde sans le rétrécir.


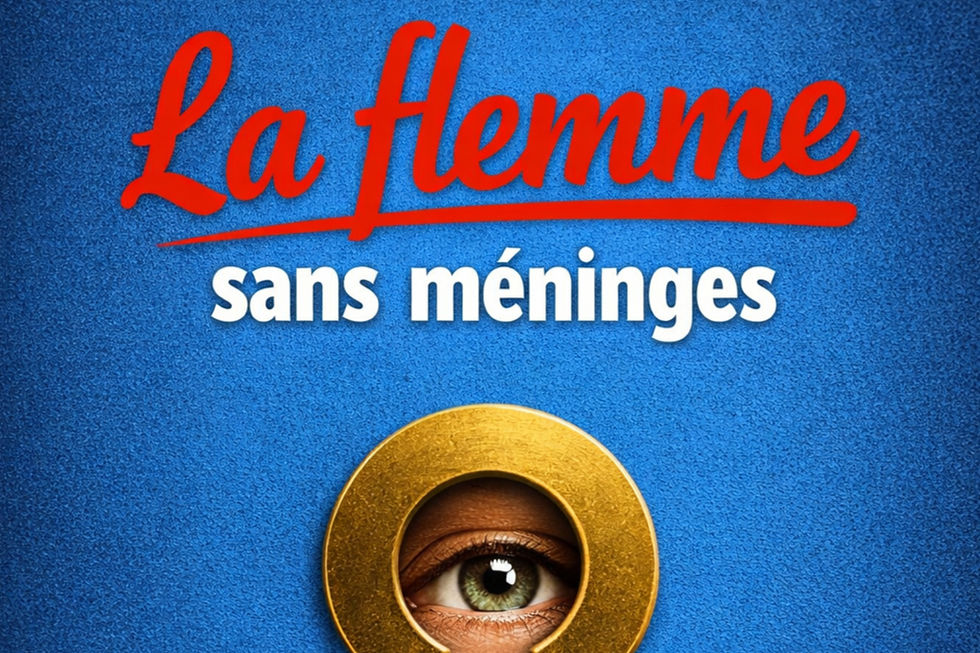

Commentaires